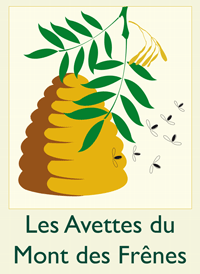Par Benoît Manet
Une curieuse ambiance régnait dans la colonie. Une odeur de découragement s’était répandue entre les rayons communiquant à la masse des butineuses un désarroi pesant. Les éclaireuses de retour, dépitées de ce qu’elles avaient vu, avaient dansé et laissé circuler ce message vibrant « mais à quoi servons-nous ? ».
Cette introduction ressemble à de la fiction et pourrait avoir été extraite d’une nouvelle de Bernard Weber1. Et pourtant, comment leur donner tort en sillonnant nos paysages et longeant les vergers, de constater que la récolte reste sur les arbres. La nature est certes généreuse et la symbiose qui dicte les plantes à fleurs et leurs pollinisateurs dans un contrat réciproque nous le prouve à l’évidence. De surcroît, cette année, tout semblait se dessiner comme jamais. Des conditions idéales à la floraison, les mêmes à la formation des fruits annonçant une récolte idéale en quantité et qualité par des fruits d’excellente conformation. Mais c’était sans compter sur le contexte géopolitique issu des tensions autour de l’Ukraine. Tel est le paradoxe de cette histoire au sens où l’idée prend une direction à l’encontre du sens commun. Il vient nous révéler la complexité inattendue de la réalité.

Poires et cueillette
Cette fermeture soudaine du marché a pour conséquence indirecte une accumulation des produits sous embargo et une baisse de prix sur le marché intérieur.
Réaction : des mesures prises dans la foulée tant au niveau régional qu’au niveau communautaire pour soutenir les producteurs se traduisant entre autres par des aides prévues pour le retrait du marché à des fins de distribution gratuite (financée à 100%), ou d’autres retraits à des fins non alimentaires ou encore de non-récolte (financé à un taux bien moindre). Mais d’emblée, les fruiticulteurs wallons ont choisi le régime de la non-récolte : une décision compensée par une aide à 2.737 EUR/ha quand même ! Mais qui semble encore insuffisante face aux coûts de production engagés et au vu des faibles prix de vente imposés par la grande distribution qui a bien senti dans quel sens soufflait le vent. Un système d’aide qui, à l’échelle des Etats membres, a obligé la Commission à revoir le régime de soutien à la hausse après qu’une première enveloppe de 125 millions EUR ait été accordée. Pour cause ? Un dépassement suite aux trop nombreuses demandes introduites à l’échelle européenne. Il faut dire que certains pays comme la Pologne ou l’Italie se montraient anormalement gourmands, déclarant des volumes largement surfaits.
Finalement, une deuxième enveloppe de 165 millions EUR supplémentaires est venue s’ajouter à ces mesures de soutien tout en rendant l’accès à celles-ci plus strict. Ces montants seront finalement prélevés dans l’enveloppe de crise du budget 2015 de la PAC. Montants qui entament d’emblée les moyens prévus en cas de crise agricole et probablement ceux accordés sous forme d’aides directes à l’ensemble des producteurs européens.
Alors est-ce la solution ? Il faut admettre que cette façon de fonctionner est surprenante, résumant toute solution à l’octroi d’aides sans vision stratégique sur les causes qui ont amené cette situation de crise. Ce qui est intolérable, c’est que, alors que certains en appelaient à un patriotisme alimentaire en privilégiant la consommation locale, d’autres choisissaient la non-récolte, ce qui est en soi une destruction de récolte. C’est surtout un non-sens alimentaire en ce début de 21ème siècle. Mais dans ce domaine comme dans d’autres, c’est la course aux profits qui mine le secteur car certains ont tout tablé sur un seul marché finissant par ne plus cultiver que des poires Conférence, le standard russe. Un modèle qui montre aujourd’hui ses limites tout en espérant qu’il puisse amener les producteurs à réfléchir à d’autres formes de commercialisation mais aussi de valorisation. Pour une arboriculture plus respectueuse de l’environnement, de l’homme et de l’abeille. Faudra-t-il reformer le Front de Libération des arbres fruitiers cher à Julos Beaucarne2 lancé pour se souvenir de la diversité des anciennes variétés. Les fruitiers sont des symboles qui nous ramènent à nos origines. L’abeille en a fait ses alliés depuis des millénaires. L’homme a bénéficié de cette alliance : croque la pomme, croque la vie !
Le petit coléoptère des ruches ou Aethina tumida

Aethina tumida adulte
By James D. Ellis, University of Florida — English Wikipédia CC BY 3.0-us
Souvenez-vous, voici quelques années, une émission de la Radio-Télévision canadienne, la Semaine Verte, présentait les désastres et les difficultés de lutte occasionnés par la présence nouvelle de ce coléoptère en différentes régions. Ce coléoptère peut se multiplier abondamment dans les colonies où il consomme couvain, miel et pain d’abeille. Son cycle de reproduction s’appuie sur une phase à l’intérieur de la ruche où les femelles pondent des grappes d’œufs dans les fissures du bois ou le couvain, desquelles se développent des larves qui sont omnivores et poursuivront leur développement à l’extérieur de la ruche en s’enfonçant dans le sol avant d’éclore et d’entamer un nouveau cycle. Les cycles successifs ainsi que la propagation amènent à des infestations qui peuvent être importantes dont les signes cliniques les plus visibles sont – hormis l’observation directe des adultes ou des larves – des souillures, des destructions de couvain et de rayons, des fermentations qui amènent à un affaiblissement de la colonie voire une désertion de la ruche.

Aethina tumida dans la ruche
By CSIRO CC BY 3.0
Le 19 septembre 2014, les autorités italiennes ont informé les instances européennes que le petit coléoptère de la ruche avait été découvert dans la province de la Calabre (sud de l’Italie). Il semble que l’infestation soit proche d’un important port maritime, ce qui pourrait expliquer la voie d’entrée de ce coléoptère en Italie. Dans un premier temps, trois colonies d’abeilles atteintes ont été détruites et une zone de protection de 20 km ainsi qu’une zone de surveillance de 100 km ont été mises en place. A la mi-octobre, ce sont finalement en tout 40 foyers dans 13 localités qui ont été découverts dans la zone de protection. On procède encore au contrôle de tous les ruchers se trouvant dans les zones de protection. Dans les zones de surveillance, les ruchers sont contrôlés par sondage et des pièges sont installés. Le déplacement de colonies d’abeilles et de matériel apicole est interdit. Depuis la première découverte, ce sont principalement des insectes adultes qui ont été retrouvés dans les ruches. Seuls 4 ruchers présentaient à la fois des adultes et des larves. Les ruchers atteints ont tous été détruits et leur environnement traité à l’insecticide. D’emblée, on remarque l’impressionnante dispersion du parasite. Ceci est également favorisé à la faveur des transhumances. Aussi, des inspections auront également lieu dans les régions voisines. En effet, la plaine de Gioia Tauro, où ont été détectées les premières infestations, est riche en cultures d’agrumes. Beaucoup d’apiculteurs y ont amené leurs ruches au printemps. Celles-ci sont ensuite déplacées dans les châtaigneraies en altitude, puis sur l’eucalyptus en floraison tardive en Crotone. On peut s’attendre à ce que des nouveaux foyers soient encore détectés. Le site de la plateforme ESA donne un point de la situation actualisée.

Larves d’Aethina tumida
By James D. Ellis, University of Florida CC BY 3.0-US
Pour plus d’informations sur le sujet :
- http://www.favv.be/apiculture/santeanimale/#aethina
- http://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i134hauser.pdf
- http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/00316/00327/index.html?lang=fr
A suivre…
Benoît Manet